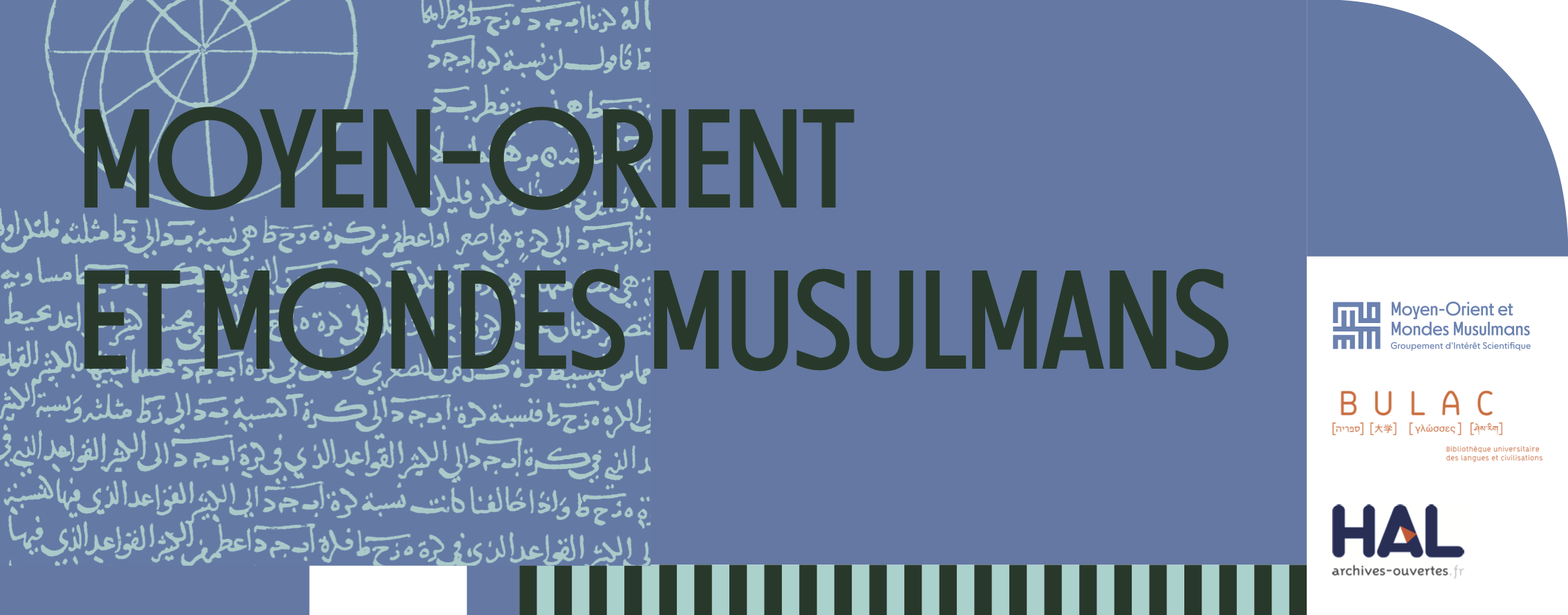Deir el-Qalaa
Résumé
Deir el-Qalaa est l’un des sites archéologiques les mieux préservés du Metn. À environ 17 km dans l’arrière-pays de Beyrouth, il occupe un éperon rocheux qui culmine à 732 m d’altitude et qui surplombe le Nahr Beyrouth, l’antique Magoras. On y accède depuis Beyrouth en empruntant la vallée de ce fleuve, puis en bifurquant vers le sud à partir du bourg de Beit Méri. Ses ruines appartiennent, dans l’état actuel de nos connaissances, aux époques romaine (Ier-IIIe siècle après J.-C.) et byzantine (IVe-VIIe siècle après J.-C.). Elles se répartissent en quatre ensembles. Au sud-ouest, en haut du promontoire qui domine la ville de Beyrouth, s’élève le grand temple tétrastyle prostyle d’ordre ionique, consacré à Jupiter Balmarcod et partiellement englobé depuis le XVIIIe siècle dans le monastère antonin Saint-Jean-Baptiste, fondé en 1750 par des moines maronites du couvent Mar Chaaya (Saint-Isaïe) de Broummana. Immédiatement au nord et en contrebas de plusieurs citernes et d’une série de marches, l’esplanade cultuelle, dallée, comprend un petit temple attribué de manière hypothétique à Junon Reine, un ensemble de chapelles et de bases destinées à accueillir des autels et des édicules à colonnettes, ainsi qu’un vaste soubassement en grande partie démonté, dont la présence laisse supposer l’existence d’un temple du même gabarit que celui du sommet de la colline. Une bourgade rurale, avec sa voirie, ses monuments publics (fontaines), ses bains, son église byzantine, ses maisons et ses installations artisanales (huileries), s’est développée plus loin vers le nord et le nord-est. À l’ouest et à l’est, enfin, les flancs rocheux du promontoire sont occupés par une zone de carrière et de nécropole, où des tombes à fosse et des sarcophages ont été repérés.
L’intérêt des vestiges et la proximité de Beyrouth, distante d’une quinzaine de kilomètres, expliquent que de nombreux voyageurs, antiquaires et savants ont décrit le site à l’époque moderne, en y relevant à l’occasion des inscriptions. L’histoire de cette découverte remonte à la visite du voyageur italien Giovanni Mariti en 1767. À la suite des explorations du XIXe siècle, surtout profitables aux études épigraphiques, le père jésuite Sébastien Ronzevalle a entrepris des fouilles de grande envergure sur place, subventionnées par l’Académie des inscriptions et belles-lettres, avant que la mission allemande de Baalbek relève le plan du grand temple en 1902. Dès lors, l’idée s’est imposée que Deir el-Qalaa était un site de pèlerinage isolé de tout habitat en même temps qu’un authentique haut-lieu phénicien semblable aux lieux de culte en plein air du pays de Canaan. Cette interprétation toujours débattue se fonde sur la présence, bien réelle, de dizaines de sanctuaires romains dans l’arrière-pays des cités de la côte phénicienne et sur l’assimilation, discutable, de la culture des fidèles de ces sanctuaires à celle des Cananéens de la Bible et à celle des Phéniciens. Elle pose le problème, impossible à résoudre faute d’arguments archéologiques, de l’existence d’un sanctuaire phénicien de l’âge du Fer et de l’époque hellénistique à Deir el-Qalaa.
De nouvelles opérations ont été menées sur le terrain depuis le début du XXe siècle. Les plus importantes sont les fouilles, suivies de restaurations et en grande partie inédites, conduites sous la responsabilité d’Haroutune Kalayan, ingénieur de la Direction Générale des Antiquités du Liban, au cours des années 1950-1970. Ces travaux ont abouti au dégagement de l’agglomération antique et de l’esplanade cultuelle, mal connues jusqu’alors. Plus récemment, l’étude architecturale du grand temple a été reprise et complétée de la présentation du village par Lévon Nordiguian. Une partie du site a été occupée par l’armée syrienne entre 1990 et 2003. Aujourd’hui, le monastère est entièrement restauré et plusieurs projets d’étude et de réhabilitation sont en cours.
Cent trente-et-une inscriptions grecques et surtout latines ont été relevées à Deir el-Qalaa et aux alentours. Ces documents apportent des informations précieuses sur les pratiques cultuelles des citoyens de la colonie romaine de Beyrouth, qui se retrouvent sur place pour rendre hommage aux empereurs de Rome (Hadrien, Septime Sévère) et pour honorer les dieux de Bérytos (le Génie, la Fortune de la colonie, Mater Matuta), les dieux d’Héliopolis-Baalbek (Jupiter, Vénus, Mercure) et le groupe des dieux locaux dominé par Jupiter Balmarcod et Junon Reine, sa parèdre. Le dossier ainsi constitué révèle que les cultes locaux ont été transformés au moment où de nouveaux édifices religieux s’élevaient sur le site. La chose est évidente à travers les dédicaces à la Fortune, au Génie de la colonie et aux empereurs de Rome, qui témoignent du rôle dévolu au lieu, celui de sanctuaire civique. Dans le même temps, les Romains de Bérytos ont formé de joyeuses confréries qui, à l’occasion de banquets festifs et de cérémonies à caractère civique, ont contribué à renouveler l’interprétation des cultes traditionnels, y compris celui de Balmarcod.
Tel qu’il est transcrit en grec et en latin, le nom de Balmarcod est bien sûr sémitique, contrairement à celui de Junon Reine. Il se compose d’un premier élément correspondant à la transcription du nom de Baal, le grand dieu oriental de l’orage, et d’un second élément tiré de la racine rqd, « sauter », « danser ». Cependant, la majorité des dédicaces qui lui sont adressées montrent surtout que, sous l’Empire romain, Balmarcod a été assimilé à Jupiter et que la nomenclature latine a été adoptée pour redéfinir son domaine d’activité : le sigle IOMB (Iuppiter Optimus Maximus Balmarcodes) a ainsi été forgé sur le modèle de celui qui caractérise les dieux suprêmes du monde romain, tel le Jupiter d’Héliopolis-Baalbek (Iuppiter Optimus Maximus Heliopolitanus), reconnaissable entre tous par le sigle IOMH. Tout comme son homologue héliopolitain, le dieu est par ailleurs affecté d’un Génie, dans la tradition romaine. De manière plus originale, Balmarcod est enfin désigné en grec comme le « seigneur des danses » ou encore comme le « conducteur des chœurs », au moyen de deux expressions qui sont liées à ses attributions et à l’étymologie de son nom.
Depuis la fin du XVIIIe siècle, la plupart des savants ont été attirés à Deir el-Qalaa par la conviction que l’étude de ce site de la montagne libanaise révélerait le passé phénicien de Beyrouth. La publication des travaux effectués dans la seconde moitié du XXe siècle ouvrira éventuellement des perspectives de recherche en ce sens. De même, elle permettra peut-être de déterminer si le sanctuaire a succédé au village ou si ce dernier s’est formé autour d’un lieu de culte préexistant. Pour l’heure, la documentation disponible confirme le caractère romano-byzantin et villageois du site plus que son identification à un lieu de pèlerinage fréquenté par les Phéniciens depuis la plus haute antiquité. Elle illustre aussi l’essor des bourgades rurales du Proche-Orient à l’époque byzantine, bien attesté au Liban à travers les exemples de Khaldé (Heldua), Jiyé (Porphyréon), Chhim ou encore Oumm el-‘Amed, tout en posant la question de la christianisation de la Phénicie.
Dans l’Antiquité tardive, le Liban a conservé longtemps une réputation de refuge païen. Le patriarche Sévère d’Antioche (512-518) fustige les démons de la montagne et leurs anciens cultes célébrés sur les sommets, dans des homélies dont la vigueur témoigne des excès de la polémique chrétienne plus que de l’expérience de pratiques collectives interdites depuis la fin du IVe siècle. Si la christianisation semble en effet plus tardive au Liban que dans d’autres régions du Proche-Orient, rien ne permet de parler de résistance païenne à propos du culte de Jupiter Balmarcod. En revanche, l’adhésion des villageois de Deir el-Qalaa à la foi nouvelle est attestée par la construction, à l’écart du sanctuaire de Balmarcod, d’une église de plan basilical venue empiéter sur les thermes au Ve ou au VIe siècle après J.-C. Comme de nombreuses basiliques de la Phénicie byzantine, l’édifice se caractérise par la présence, au milieu de la nef centrale, d’un espace carré, délimité par des barrières et accessible par une entrée entre deux colonnes. Les spécialistes d’architecture chrétienne donnent le nom de « chœur 2 » à ce dispositif, pour le distinguer du chœur simple ou presbyterium des autres églises. Ils supposent qu’il servait, comme le bêma surélevé des églises de la Syrie, au rassemblement d’une partie du clergé ou des chantres et à la liturgie de la parole.
Le présent ouvrage ne vise pas à traiter de manière exhaustive l’ensemble de la documentation disponible sur le site antique de Deir el-Qalaa. Il réunit une série d’études d’épigraphie, d’architecture et d’histoire, illustrées de nombreux documents inédits. On y trouvera tout d’abord le recueil des inscriptions grecques et latines découvertes sur place et des dédicaces relatives à la diffusion du culte de Balmarcod et de Junon Reine dans le monde romain. Suivent trois études d’architecture, consacrées au grand temple de Balmarcod (par Thibaud Fournet), à l’église Saint-Jean-Baptiste du couvent moderne (par Lévon Nordiguian) et aux thermes romains et byzantins du village antique de Deir el-Qalaa (par Gérard Charpentier et Thibaud Fournet). Une quatrième contribution (par Frédéric Imbert) concerne l’inscription arabe d’une tuile découverte dans les années 1950-1960, unique témoignage de l’occupation du site à l’époque médiévale. Le dernier chapitre présente le projet de valorisation du site (par Yasmine Makaroun et Tania Zaven). Le livre est complété de d’index développés et d’une bibliographie complète.
Cet ouvrage n’aurait pas vu le jour sans le soutien bienveillant de la Direction Générale des Antiquités du Liban, de son ancien directeur, M. Frédéric Husseini, de son directeur actuel, M. Sarkis El-Khoury, et des directrices successives du Musée national de Beyrouth, Mmes Suzy Hakimian et Anne-Marie Maïla-Afeiche. Il n’aurait pu être mené à bien non plus sans l’aide amicale et enthousiaste de Mme Tania Zaven, archéologue responsable de la région du Mont-Liban, de Mme Rana Andari et Mlle Carole Atallah, autrefois chargées de l’inventaire des monuments conservés à Deir el-Qalaa et au Musée national de Beyrouth, et de Mme Hala Boustany, responsable de la rédaction du Bulletin d’archéologie et d’architecture libanaises.
Au Liban, je suis aussi reconnaissant aux Pères Roland Mrad et Maroun Abou Rahal, supérieurs du couvent Saint-Jean-Baptiste, de m’avoir permis de revoir les monuments entreposés dans le monastère et de nous avoir ouvert l’accès, à MM. Thibaud Fournet, Lévon Nordiguian et à moi, aux parties du grand temple qui sont toujours recouvertes par l’église moderne de Deir el-Qalaa, afin de confronter nos archives à l’examen des vestiges en place. À l’American University of Beirut, il m’est agréable de remercier à nouveau Mme Leila Badre de nous avoir confié, à M. Jean-Baptiste Yon et à moi, la publication des inscriptions du musée, parmi lesquelles figure une dédicace latine de Deir el-Qalaa. À l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, je suis redevable à Mme May Semaan Seigneurie, ancienne directrice de la Bibliothèque Orientale, et à M. Lévon Nordiguian, directeur de la Photothèque, d’avoir pu exploiter les archives de Sébastien Ronzevalle. Je dois par ailleurs à Mmes Yasmine Makaroun et Jeanine Abdul Massih de pouvoir présenter un nouveau plan du site antique de Deir el-Qalaa. Réalisé à partir de relevés topographiques effectués dans les années 1990, ce plan a été entièrement révisé par les soins de Mme Pauline Piraud-Fournet et de M. Thibaud Fournet, grâce au soutien financier de l’Ifpo.
En France, les inscriptions de Deir el-Qalaa et la documentation relative au site qui sont conservées au musée du Louvre ont été révisées avec l’autorisation de Mme Marielle Pic, directrice du département des Antiquités Orientales, et de Mme Françoise Gaultier, directrice du département des Antiquités grecques, étrusques et romaines. J’ai aussi pu consulter avec profit et photographier les estampages de William Henry Waddington à l’École Pratique des Hautes Études avec l’aide de Mme Margot Georges, ainsi que les archives d’Henri Seyrig conservées au conservées au département des Monnaies, médailles et antiques de la Bibliothèque nationale de France, avec l’autorisation de Mme Frédérique Duyrat. MM. Pierre-Louis Gatier, Jean-Paul Rey-Coquais et Jean-Baptiste Yon ont bien voulu se charger de relire le manuscrit du corpus épigraphique à divers moments de sa préparation et de me faire part de leurs critiques et de leurs suggestions.
À la Maison de l’Orient et de la Méditerranée de Lyon et au sein du laboratoire HiSoMA (Histoire et Sources des Mondes Antiques), l’Unité mixte de recherche 5189 du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) dans laquelle je suis affecté, Mme Elysabeth Hue-Gay, ingénieur en édition, m’a prêté main forte avec patience et efficacité lorsqu’il s’est agi d’actualiser la mise en forme et l’indexation du corpus épigraphique de Deir el-Qalaa. Ce recueil a été réalisé à partir de l’édition numérique des inscriptions de Deir el-Qalaa encodées selon les standards de la Text Encoding Initiative (TEI) et du modèle EpiDoc. Avec l’aide de l’équipe du projet Métopes (Méthodes et outils pour l’édition structurée), placé sous la responsabilité de M. Dominique Roux et développé dans le cadre des activités du Pôle Document numérique de la Maison de la recherche en sciences humaines de Caen, il a bénéficié en particulier de l’expertise de Mlle Edith Cannet, ingénieur au CNRS. En ce sens, le travail qui suit contribue aux avancées en cours du programme de recherche international des IGLS, en particulier pour le corpus de Beyrouth et de sa région, tout en renouvelant les perspectives de travail sur la capitale actuelle du Liban et son arrière-pays montagneux.